https://www.uphf.fr/agenda/exposition-corps-en-partage
https://www.pu-valenciennes.fr/os01.htm
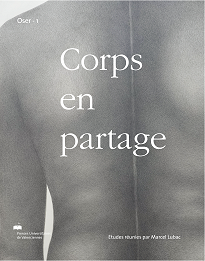
Portrait de l’artiste en trouvère
Préambule
Il y a tant à dire, à partager, à observer. Dans les micros-grammes, les infra-minces. Plus il s’approche de la matière du réel, plus il s’en éloigne. À la place, des traces, des espacements. Lorsqu’il travaille, il est obligé de prêter attention à ce qui est minuscule, infime. Il ne porte pas de lunettes, il n’utilise pas de loupes, pourtant son observation spontanée le conduit à s’intéresser à des détails extrêmement précis, à des toutes petites manies, quelque part au bout des matériaux, dans leur façon de réagir. Le plâtre. Le plâtre ! Sur son visage, sur ses jambes, ses mains, ses pieds. La sensation de froid et de durcissement. Puis la chaleur. Les picotements de la brûlure de la peau qui se dessèche sous la peau de toile plâtrée tendue. Il s’est protégé par une fine couche de graisse et un film papier, mais la peau et les poils tirent, la peau brûle, tranquille, respire, tranquille, sous la couche de graisse et de poudre agglomérées qui sèchent au-dessus de son épiderme. Tandis qu’il respire, c’est la terre qui se dessine sous ses yeux, entre ces fines couches, pendant ce moment d’apprêt durant lequel il effectue un moulage de son avant-bras. Vestige de la mémoire des expérimentations tectoniques, la création de l’univers ressenti à l’aune du bruissement de l’épiderme, des tensions suggérées par l’appui. Comme lors d’une pérégrination expiatoire. Comme lorsqu’il part marcher sur des kilomètres, il part de chez lui, il ferme la porte à clef, et il s’extirpe du monde en le franchissant pas à pas.

Nul besoin d’être trop équipé ni appareillé, surtout pas d’appareils à l’obsolescence programmée, pas trop connecté, juste ce qu’il faut au cas où, en cas d’urgence, et encore. L’idée c’est d’aller à la rencontre du monde et d’autres personnes, il y aura bien toujours quelqu’un pour le renseigner, quelques cartes IGN suffiront. Il n’est pas question ici de prévoir quoi que ce soit, la marche ne s’entremêle pas nécessairement aux projets d’œuvres, de constructions, d’installations, qui sont au cœur de sa démarche artistique, bien qu’en chemin, il va apprendre à concevoir un four à cuisson pour la céramique. C’est un autre espace à l’occasion duquel se renseigner sur le monde et sur son histoire. En définitive, la connaissance historique n’est pas un labeur intellectuel, c’est le travail du marcheur.
Gnose 1. Laisser ses chances à l’initiation, loin de la grâce des motifs
Il s’est laissé filmer en train de réaliser des moulages de ses pieds. La caméra propose des gros plans, des très gros plans ou des plans rapprochés. Le sol est gris, parsemé de diverses poussières et de marques de frottements, c’est un endroit de travail. Son corps est en action, plié en deux pour mieux approcher le sol, plus précisément, les pieds posés au sol. Les gestes sont rapides et nets, des petits coups pour que le pied gauche, celui du genou plié, l’autre étant au sol, donnés par les mains, sur les morceaux de terre ocre rouge encore crue qui entoure le pied, pour que le pied gauche, soit recouvert de terre, entièrement, jusqu’à la cheville. Les poignées de terre crue sont saisies à pleines mains, lesquelles les dissolvent autour du pied afin qu’elles ne forment plus qu’une seule masse, couche après couche, étalement après étalement, martellement après martellement. Il y a du bruit et de la danse dans l’imagination de celui qui regarde, pourtant le film est muet, il n’y a pas de son, car le bruit n’a peut-être pas été enregistré, parce que de la terre crue sur de la peau, ça ne s’écoute pas, ça se ressent de l’intérieur ou ça se regarde, ça réinvente les bruits de tout ce qui ne peut pas s’écouter d’habitude : frottement, arrachage, pincement, picotement, enfoncement. Ailleurs : découpage, nettoyage, façonnage, brassage, nouage, amoncellement, clouage, martellement (ci-déjà nommé), emboîtement, enfournage, liquidation, accumulation, liquéfaction, cuisson, séchage, fixage. Création des lieux de l’atelier, lorsque celui-ci se sédentarise et se calcifie un temps pour être mieux pulvérisé dans la main de l’artiste démultipliée, sur ses pieds renchéris de doubles, de triples, de quadruples jeux de chair et d’os, moulés, démoulés, surpiqués. Peut-être. Le vide entre le pied et la terre n’existe plus, le pied est enfermé sous cette matière humide, souple et granuleuse, il ne respire pas, il se tait, car il n’y a plus d’air, et il fait noir, la lumière ne passe pas.
Le corps a été filmé, on le reconnaît lui, ses cheveux, ses poils, sa peau, le bleu du jean et le vieux rose du t-shirt en coton. Ce sont des parties de corps. Ce n’est pas un plan séquence, la caméra ne dit pas tout, le pied n’est pas filmé lorsqu’il l’extrait de la terre, qui en garde l’empreinte à l’intérieur de sa masse. Cette terre molle garde la trace de tout ce qui la touche, ce qui provoque à sa surface des liserais, des craquelures, des brèches, des entailles, des gouffres et des vaguelettes. Point. On n’ira pas plus loin ; cependant, on pourrait continuer à concéder au langage la possibilité de dessiner le temps, tandis qu’il est si beau de regarder s’y vivre. Mais à présent, l’énumération s’arrête, haletante, un tant soit peu hésitante, brève apparition graphique de la pensée. Onirisme du volume, de ce qui fond, s’obstrue, dégouline. Sa peau, sur le côté de son pied, présente de multiples replis recouverts de particules de terre. Il a recommencé plusieurs fois la même déroute, la même manœuvre, le même artisanat. De sa main gauche, il recouvre sa main droite posée au sol, les doigts écartés de quelques degrés, approximativement 30. La danse avec tous ces bouts de soi continue, c’est très physique, fatigant, éreintant mais c’est protecteur. La fraîcheur du contact de la terre sur la peau qui en boit l’humidité lui indique avec force évidence la durée du temps de saisie ; ce moment où la matière s’est figée et dont il faut extraire le membre. Ce membre est un pied gauche, une main droite, dans le film. Parfois le membre provient d’autres endroits du corps, comme la partie inférieure du visage, le dentier, le milieu du visage avec l’arcade du nez, les paupières, la partie inférieure du corps, des pieds au haut des cuisses et aux fessiers, l’un des bras. Il donne son corps au mouvement de la terre crue pour qu’il soit restitué à travers le coulage et le durcissement du plâtre qu’il verse dans les vides des empreintes. Cette chance d’appartenir à la matière se mesure à l’aune de la quantité de plâtre employée. Serait-ce la quantité de subjectivité laissée derrière soi ? Ça y est, il a réussi à créer une image.
Gnose 2. L’intuition, sans couronnes ni pensées
À Arras au Moyen Âge, existait la léproserie de Saint Nicolas de Méaulens située à Beaurain. C’est là que Jean Bodel au cours de l’année 1202, composa les 45 strophes des Congés afin de dire adieu à ses proches, à ses mécènes et au monde. Atteint de la lèpre, et se sachant condamné, il se retire du monde après avoir pris la croix pour participer à la IVe Croisade. La lèpre est une maladie de la peau. On raconte que les croisades ont largement contribué à sa propagation. Certains lépreux devenaient ensuite des pèlerins solitaires. Une autre maladie du Moyen Âge qui altérait également les membres jusqu’à leur gangrène était, elle, provoquée par l’ergot du seigle. On l’appelait le mal des ardents ou « Feu de Saint-Antoine » ; des sensations de brûlures vives et douloureuses pouvaient être accompagnées d’épisodes hallucinatoires. Saint-Antoine qui avait résisté au « feu de la tentation » dans le désert lors de son ermitage, devint tout naturellement le saint protecteur des personnes atteintes de ce mal et recueillies par les Antonins dans leurs ordres hospitaliers. Nous en connaissons certaines représentations, notamment celle du peintre flamand Jérôme Bosch dans le triptyque qu’il consacre au saint, aux environs de 1501. Dans cette version du retable qui est conservée à Lisbonne, on aperçoit des malades atteints de ce mal, en attente de guérison, et certaines figures volantes qui pourraient s’apparenter à leurs sensations de flottement et à leurs hallucinations, provoquées par l’ergot mais également par les remèdes qu’on leur proposait afin d’atténuer leurs souffrances et de les anesthésier avant l’amputation.
Parfois suspendus aux murs d’enceinte des hôpitaux ou conservés dans les églises, des exvoto anatomiques présentaient en guise d’offrande au saint protecteur le moulage de la partie du corps malade : un pied, une jambe, une main, un bras, mais aussi le visage, la gorge, ou encore, en cas de guérison, la figure votive de la personne toute entière est moulée à la cire. Il est difficile de ne pas faire le lien entre l’œuvre de Damien Gete, ses moulages, ses assemblages, ses sculptures et ses bas-reliefs, d’ailleurs qualifiés d’ex-voto, et l’ensemble de ces traditions iconographiques et populaires à la fois, qui comportent une relation spirituelle au monde, dont le corps porte la trace. De même de l’importance de la marche et de la danse pour l’artiste, qui rappelle à quel point se situer à un moment précis dans l’espace, et y faire évoluer une forme ou un mouvement, s’inscrit dans une démarche à plus long terme, nous inscrit dans la durée.
Ainsi d’une association possible et hasardeuse entre deux œuvres très différentes mais dont le rapprochement fait sens : entre la sculpture de Damien Gete intitulée Par le moindre vestige et un personnage issu du célèbre triptyque du Jardin des délices peint également par Jérôme Bosch, conservé au musée du Prado à Madrid et daté entre 1494 et 1505. Assemblage réalisé en 2021, Par le moindre vestige est composé de feuilles d’essences diverses, de branchages et d’herbes sèches, enchâssés dans de la cire et des pigments qui semblent avoir été directement déversés dessus, de tasseaux de bois et de plusieurs moulages de mains et de pieds. Outre l’allusion à la technique de la chronophotographie de par l’agencement des tasseaux qui se terminent par les moulages des membres de l’artiste, de façon à se succéder visuellement, comme dans la décomposition photographique de la marche, maladroitement, de guingois, pas après pas, comment ne pas l’associer à l’ « Homme-arbre » du panneau de droite du Jardin des délices, qui regarde le spectateur ? Personnage énigmatique, peint dans des gris laiteux et se situant sur le panneau de l’Enfer, il est coiffé d’un plateau circulaire sur lequel dansent de minuscules personnages qui tournent autour d’un instrument de musique, vraisemblablement une cornemuse. Le corps de l’homme est ovoïde et nous tourne le dos. Il ressemble à un pachyderme ou à une coquille d’œuf craquelée, fendue à l’arrière. L’intérieur est creux et accueille là encore des petits personnages affairés. L’un d’entre eux s’est saisi d’une échelle qu’il gravit afin d’atteindre cette antre étrangement sombre, supportée par deux membres hybrides, entre la jambe à la musculature souple et ployée et la branche noueuse aux ramifications effilées comme des aiguilles, épines qui transpercent ses propre parois. C’est drôle et effrayant à la fois. On dirait du plâtre, ou une figurine de tendre pierre calcaire, qui se serait animée pour nous, sortie de son dais.
Scorie. Monument
Nous sommes à la fin du mois de février 2022. Damien Gete prépare le second temps d’exposition de sa résidence à l’Être lieu. Il a construit des espèces de petites architectures avec du bois récupéré, qui rappellent un peu les gestes du peintre et sculpteur Jean-Pierre Pincemin, dont l’une des œuvres en volume est conservée au Muba de Tourcoing. Lorsqu’on la regarde, même si elle est sans ouverture, on perçoit le vide qu’elle contient, comme un caisson. Elle est fabriquée grâce à l’agencement de facettes de bois peintes fixées les unes aux autres. Elle n’est pas cubique mais plutôt dissymétrique. Damien Gete prépare un peu de cela dans sa future installation : des caissons, des petits monuments, conçus selon les dispositions des matériaux à se joindre, se soutenir, façonner un lieu, entourer du vide, avec des semblants de boîte, parvis, pilastre, fronton… plexiglas, bois aggloméré, polystyrène… glissements des formes aux matériaux et inversement, synecdoques autoproclamées, comme autant de traces de notre civilisation.

L'H du Siège
Un projet 2016 Labex Arts H2H du laboratoire AIAC de l’université de Paris 8, des Archives nationales site de Pierrefitte-sur-Seine, de la Macc, associés à trois galeries parisiennes (la galerie Bernard Ceysson, la galerie Jean Fournier et la galerie Bernard Jordan).

Préparation de l’exposition Archives rêvées, mémoires de peintres, aux Archives nationales de Pierrefittes-sur-Seine, à l’avant, dessins, boîtes et objets de Joël Kermarrec, à l’arrière oeuvres de Jean Lancri

Vue de l’exposition en préparatifs, Archives rêvées aux Archives nationales, avec la vitrine de Jean-Olivier Hucleux

Table ronde à la galerie Bernard Jordan, janvier 2016, exposition J.-F.Chevrier, A.Sicard & A.Vérot, sur la photo, C.Lubac, E.Bonnet et P.Wat (©Parya Vatankhah)
Du 20 septembre au 19 novembre 2016, dernière exposition de la Maison d’art contemporain Chaillioux de Fresnes (94), avec des oeuvres de Franck Chalendard. Vernissage le samedi 17 septembre de 11h à 18h à la Macc, puis la suite à la galerie Bernard Ceysson Paris qui expose l’artiste du 17 septembre au 15 octobre 2016. Vernissage à partir de 18h!
—
Maison d’Art Contemporain Chaillioux
Paul Verlaine, 1874
Portrait d’un tableau
Il faut d’abord préciser que Didier Demozay est peintre. Il peint des tableaux non figuratifs, non narratifs, non formels. Pas de projection possible au sein d’une histoire ou d’un signe, pas de tableautin, de portraiture ni de décodeur.
[…]
Et Demozay de préciser dans un entretien (toujours pour l’expo du château de Ratilly que nous avons eu la chance de visiter, raison pour laquelle nous l’évoquons) : « (…), je suis un peintre en marge des productions actuelles dites contemporaines ; (…) cependant je pense être un peintre qui vit son époque avec une sensibilité différente, peut-être. C’est aussi très intéressant de se situer ailleurs. Je ne suis pas un cas isolé, ni un moine reclus dans son atelier, je fréquente des écrivains, des historiens de l’art, des philosophes et bien évidemment des peintres. » Nous aimerions porter l’attention du lecteur au-delà de ce cercle socioculturel que décrit l’artiste qui nous semble pourtant l’isoler de nouveau. Une solitude est sans doute nécessaire et si elle est palpable, c’est l’œuvre qui la livre, le cercle magique ne peut être brisé par quelques représentants. Cela va plus loin.
Nous aimerions interroger la contemporanéité du travail de Didier Demozay là où il se fait, dans un atelier, mais dans un endroit peuplé d’images aussi bien : celles que l’on ne peut ignorer, qui font partie d’un consensus et d’une mise en forme, qu’on le veuille ou non, qu’on le déplore ou pas. Ce fait que nous vivons à travers des supports de communication qui peuplent nos vies de « vivant ». Indéniable. Pourquoi et comment cet artiste s’en sort-il vivant ? A-t-on fait le vide à sa place alors que s’y passe-t-il ? Comment récupérer, rattraper l’image qu’on lui a volée avant qu’il ne délibère et légifère de son existence ? Le vide, de nouveau, mais pas dans le tableau, couleurs passées à la brosse. La contemporanéité de l’œuvre de Demozay résiderait dans cette façon de placer les sensations physiques entre des images, sans nous montrer à quoi elles ressemblent, au grand jamais ce n’est pas le propos, car elles ne ressemblent à rien à partir du moment où nous ne les investissons d’aucune mystification.
Le choc d’une collision agit en repoussoir d’une masse à l’autre : un jeu d’auto-tamponneuses, fort de sa porosité, a une vie « cadre » en-dehors du tableau, à travers des variantes de couleur, un noir rencontre un jaune, souvent le noir fait pendant, au vert, au rose aussi. Cadre de vie, cadre visuel, cadre commun, etc., sont moins l’écho d’une répétition cadrée que la présence du corps dans le vide des formes, et du choc extrême qui en découle. Vie du monde, vie de l’œuvre, quand elles ne font plus qu’un, parce que tout est lié dans ces interstices du corps à corps, coude et cœur accrochés. Ces extrémités phénoménologiques existent aujourd’hui à faire de la peinture une histoire. Certes nous n’avons plus besoin de la technique picturale pour obtenir et conserver une image du monde. L’appareil photo et les caméras le font beaucoup plus vite et à bien plus grande échelle, d’autant qu’on n’est plus « obligé » de passer par une subjectivité humaine ce qui peut-être par ailleurs désubjectivise notre relation au sujet (souriez vous êtes filmés) !
Mais il y a encore le besoin de montrer et de simuler et stimuler les fractures, les endroits mauvais, là où ça frotte et où le corps impondérable déplace l’air qu’un courant délicat caresse. La délicatesse de cette violence qui ne dit mots. Nous avions cru que chez Demozay il n’y avait pas de figures. Elles traînent sans pour autant se dévoiler. Par contre on les entend les demoiselles. Ce sentiment à regarder ces surfaces de couleur que l’artiste revendique en tant qu’il n’est pas coloriste, que rien ici n’est silencieux, que ça parle, ça évoque, ça butine. C’est pour cette raison que l’artiste peut s’exprimer sur l’aboutissant de ses émotions, peinture du registre préverbal déjà accoutumée au langage. Nous pourrions dire prédisposition au futur, déjà réalisé dans le présent, dans cette part d’investissement imaginaire qui fabrique le passé : les couleurs de Didier Demozay ne débordent pas du cadre et ne dégoulinent pas, elles lui passent carrément au-dessus.
Pour nous Didier Demozay ce n’est pas la référence sérieuse à la peinture ancienne ou à la peinture muette et silencieuse du XXè siècle, parce qu’on l’a beaucoup dit d’un peintre comme Bram Van Velde ou même de la littérature de Samuel Beckett et si nous les admirons et les apprécions nous préférons remettre le temps en situation d’être, notre contemporain, à travers une œuvre de peintre.